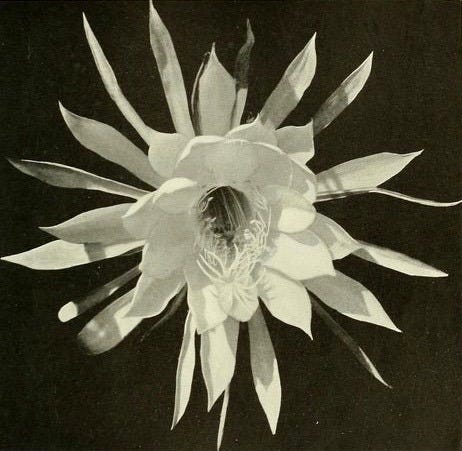C’est un immeuble des années 1960, avec des volets en bois lambrisés et des murs beiges, partout des formes carrées. Le carrelage de la terrasse est de trois ou quatre teintes de marron différentes, fait de rectangles de tailles variées. Il est moche, on s’y fait très bien.
Le balcon donne sur cinq peupliers. Ils sont proches, une dizaine de mètres pas plus. Au troisième étage, on est face au dernier tiers. Depuis l'intérieur de la pièce, la fenêtre et la baie vitrée sont entièrement vertes, le feuillage prend toute la place. La cime des arbres on ne la voit jamais de face normalement. Ça fait six mois qu’on est là, ma mère qui vient régulièrement a rempli le balcon de plantes. Je me dis que dans quelques années, quand la glycine, la passiflore et le jasmin auront grossi, on vivra littéralement dans un nid. Déjà là, ça déborde.
Les pièces ont été repeintes en blanc, la cuisine est la seule pièce qui fait son âge. Des tomettes orthogonales recouvertes d’un vernis bien tâché. Les portes des placards sont du même bois orange que les volets et la crédence est en carreaux gris et bleus sur lesquels sont dessinés des petits personnages normands ou alsaciens. Tout en long, elle finit par une fenêtre qui s’ouvre sur un grand morceau de ciel. Le soir il va du jaune pale, au ras des toits, à l’indigo. Le plus souvent il reste des lambeaux de nuages, parfois c’est parfaitement clair, un dégradé sur lequel se détachent les silhouettes des cheminées, des avions et des oiseaux. L’atmosphère de la pièce au crépuscule donne envie d’y passer des heures. Il m’arrive de remplacer la salle de bain sombre par l’évier de la cuisine pour me brosser les dents en regardant dehors.
Il y a quelque chose qui me touche parfois en ouvrant les placards. J’ai cette impression d’enfant chez ses grands-parents, qui se réjouit d’une maison qui n’est pas la sienne. La sensation de placards remplis de provisions, de murs qui protègent, de famille qui veille, alors même qu’on n’est que deux et qu’on participe ensemble à les remplir. C’est précisément dans les placards que je ressens le fait de ne pas être seule.
Dehors, l’un des trucs que je préfère c’est les toits des maisons sur lesquelles on donne. À droite il y a une grande barre, à gauche une petite bâtisse similaire à la notre. Il y a aussi des bâtiments parisiens pas très hauts aux toits en zinc. Mais surtout il y a des maisons de ville d’un seul étage aux toits en brique. Leurs lignes fragiles ne sont pas droites, les aplats de tuiles pas complètement plats. Elles ont l’air dessinées d’une main qui tremble et je les aime beaucoup. Parfois la nuit, une fenêtre de l’immeuble d’en face brille à travers le feuillage, ça fait comme une lueur sur une montagne endormie, une impression de chaleur qui n’est pas la notre.
Dehors il y a un banc qu’ont laissé les propriétaires, copie conforme de ceux de parcs parisiens sauf que l’armature n’est pas en fer mais en plastique sombre, ce qui le rend très léger. Je le traine au milieu du balcon pour qu’il soit collé aux barreaux. Allongée dessus la tête en l’air, je vois mieux le ciel. Le dos à plat sur le banc, les genoux pliés parce qu’il ne fait pas deux mètres non plus, je regarde la cime des arbres à ma droite. Ça fait penser à la plage. Le mouvement dans les feuilles calme le cerveau comme la surface texturée de la mer. Il paraît qu’en fixant ces minuscules ondulations, ça laisse de la place, ça détend. Calée comme ça, avec rien d’autre à faire que de poser le regard sur des mouvements réguliers des feuilles et des oiseaux, j’ai encore l’impression d’avoir sept ans. Le ciel n’est pas spectaculaire mais je fixe un gros nuage. Je suis des yeux les hirondelles qui fusent au travers de mon champ de vision. Il y en a des tellement hautes que lorsqu’un pigeon surgit à juste une dizaine de mètres au-dessus de ma tête, je sursaute. Il infléchit sa trajectoire droit vers moi, j’ai l’impression d’être repérée. Parfois certains vol donnent le vertige. Ils ont tendance à se jeter des immeubles sans ouvrir leurs ailes, ne les déployant qu’après avoir chuté pendant un moment. Ça donne des piqués étourdissants. On les connais bien maintenant. On observe les bastons inter-espèces, corbeaux contre pigeons ramiers, hirondelles, mésanges, geais de chêne, couples de perruches vert fluo. Je sais qu’il y a des gens que ça passionne, mais moi je n’ai jamais prêté attention aux oiseaux. Maintenant, même sur un boulevard à Paris, je les regarde passer.
Une connerie de santé m’a fait lever le nez et regarder le ciel plus que d’habitude. Comme la moitié des trentenaires que je connais, j’ai des soucis oculaires. Dans mon cas, l’inflammation des paupières, récurrente, me tient souvent loin de toute lumière bleue. Je n’ai pas le choix parfois que de reposer mes yeux, de ne pas rajouter une couche aux cinq heures quotidiennes d’écran. Je lis moins. Parfois plus du tout même. Au début, quand le problème s’est posé, l’idée qu’un problème physique m’empêche de lire me rendait malade. Ça n’avait aucun sens. Comment une telle activité pouvait faire du mal au corps ça dépassait toute logique. Là je suis plus en paix. J’écoute des podcasts et des émissions de radio. Dans le métro déjà, et je m’occupe en regardant les fringues des gens. Chez moi je cale une émission dans une petite enceinte et je m’exile sur le balcon. Les semi-siestes estivales conviennent parfaitement à une écoute tranquille.
J’ai écouté en quelques jours les épisodes de Bookmakers consacrés à Wajdi Mouawad et à Constance Debré. Au-delà de leur qualité démentielle, les deux ont créé chez moi une fascination subite, comme si quelque chose avait bougé, s’était légèrement décalé. Ce sont des écrivains que je connais mais que je n’avais jamais lu. Mon père m’avait offert Love Me Tender de Debré à sa sortie en 2020. Aujourd’hui ses pages sont déjà un peu jaunies. De Mouawad j’ai vu deux pièces de théâtre, dont Tous des oiseaux qui m’avait bouleversée, et Incendies, le film adapté par Denis Villeneuve de sa pièce du même nom. On n’avait pas parlé pendant 30 minutes avec ma cousine, en sortant du cinéma.
Malgré des œuvres qui n’ont strictement rien à voir, la manière dont la violence construit une œuvre et un rapport au monde comporte des parallèles. Debré descend d’une lignée de médecins et d’hommes politiques, elle a grandi auprès de parents toxicomanes, exercé comme avocate pénaliste et changé de vie, tout plaqué à 43 ans. Mouawad est dramaturge, a commencé comme acteur, son enfance et sa jeunesse marquées, après des années de bombardements, par le déracinement et l’exil de sa famille de Beyrouth à Paris puis Montréal. Ils ont tous les deux perdu leur mère très tôt, 16 ans pour elle, 19 pour lui.
Au début de l’interview, Richard Gaitet pose toujours la même question : quel est le mot qui résume le mieux votre univers littéraire. « Un. seul. mot. » Tous ses invités respectent la consigne et répondent. À la place, Mouawad égrène une ribambelle de synonymes et Debré rétorque hors de question, j’écris des livres entiers, ce n’est pas pour les résumer.
Si ces interviews m’ont fascinée, c’est pour le rapport au mal que ces deux-là assument. Une fascination pour les criminels déjà, faute de meilleur mot. Lui a mis au coeur de son oeuvre la noirceur regardée dans les yeux, la guerre, l’ascendance, la famille, l’appartenance religieuse. Chacune de ses œuvres commence par un décès. Chez elle, trois romans sur quatre sont des autofictions qui portent sur sa lignée, son père, l’enlèvement de la garde de son fils, son trait tiré sur la famille et l’hétérosexualité. Ils témoignent tous les deux d’une capacité à ne rien ressentir, à devenir des toiles blanches face au drame. Elle dit, quand on perd sa mère si jeune et que ça va, on se dit qu’on est préparé à tout.
Et puis il y a la façon dont tout ça transforme. Chez Mouawad il y a des extrémités incompréhensibles. Il raconte avoir fait des propositions de mise en scène impossibles, par exemple, que le spectacle commence par un personnage qui se passe la corde au cou et annonce qu’il va se pendre et qu’il faudra que quelqu’un dans la salle vienne soulever ses jambes. Il dit, soit quelqu’un le sauve, soit il meurt. Ou bien que chaque spectateurice se voit distribuer une petite lame de rasoir pour se couper une veine et laisser couler un filet de sang qui, grâce au sol incliné de la salle, formera mêlé à d’autres une petite marre au pied de la scène. Alors la représentation pourra commencer. Ces propositions ont été refusées par les troupes. À l’écoute de l'interview j’ai un vertige, me demandant comment l’homme qui parle pouvait être celui qui tenait des propos si sensés et sensibles la minute d’avant.
Debré écrit au début de Love Me Tender « Je ne vois pas pourquoi l’amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s’aimer. Pourquoi on ne pourrait pas rompre. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s’en foutre, une fois pour toutes, de l’amour. » La phrase figure sur la quatrième et a fait que jusque-là je ne l’avais jamais ouvert. Apres les épisodes, j’ai fini par le lire et j’ai eu l’impression de comprendre. En écoutant cet extrait de L’esprit critique, j’ai mieux compris encore. Que toute la force de Debré réside dans ses contradictions, que quand elle écrit ce genre de propos elle donne la parole à une partie d’elle-même seulement. Que cette épaisseur se superpose à toutes les autres, que dans un bouquin qui parle de la douleur à hurler de s’être fait retirer son fils, même sans jamais détailler cette douleur - « les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes » - on ne peut pas penser un seul instant qu’elle n’est pas là. On ne voit qu’elle.
Cette pose, comme le dit un journaliste de L’esprit critique, cette immense posture qu’on entend dans ses mots n’est pas moins vraie. Elle expose et met à plat l’un des feuillets de sa psyché, le moins assumable et le plus provocateur, et c’est d’une grande force. Alors oui, ça ne doit pas être évident de mener une vie guidée par cette voix-là. À titre personnel je me souhaite tout sauf la proximité avec des gens comme ça. Mais elle parvient à transformer le geste en littérature, qui fonctionne parce qu’elle l’épouse, qu’elle est ce geste. Et ce n’est pas rien.